Management, modes et travaux
19/04/2024
Organisation de l’action collective, le management est-il d’abord une pratique, plutôt qu’une discipline à fondements scientifiques ? À chaque entreprise sa méthode ?
Suzy Canivenc : Vaste question qui en rejoint une autre : les qualités managériales renvoient-elles à l’acquis ou à l’inné ? En d’autres termes, le management peut-il s’apprendre, ou naturellement certains font-ils de bons managers et d’autres non et on ne peut rien y changer ? Il y a des fondements scientifiques au management, dont les premiers ont été posés par Taylor et Ford (division du travail et spécialisation des tâches par exemple). Un autre courant scientifique a ensuite souligné les dimensions humaines oubliées par le taylorisme-fordisme avec les psycho-sociologues de l’école des relations humaines, pour faire du management une pratique qui va au-delà de la logique technicienne des ingénieurs.
Le management nécessite de comprendre les subtilités de la psychologie et de la dynamique de groupe, qui diffèrent d’un individu et d’un groupe social à l’autre : il est difficile d’appliquer une recette magique qui fonctionnerait partout (le “one best way” de Taylor). Au-delà des compétences gestionnaires, il est essentiel de détenir des connaissances en sciences humaines et sociales. Et la pratique est essentielle pour transformer ces connaissances en compétences situées, adaptées aux spécificités d’une organisation – de plus en plus d’entreprises conjuguent les formations classiques de perfectionnement au management avec des « communautés managériales » où les managers d’une même entreprise parlent de leurs difficultés à exercer leur métier et de leurs pratiques.
Ballottées d’un modèle à l’autre
Les modes managériales sont-elles le signe d’un mal-être de l’entreprise, en quête d’une méthode idéale illusoire ?
S. C. : Les entreprises ont toujours été en quête de bonnes pratiques de gestion, pour assurer une organisation optimale de leur activité. Ce qui est inquiétant, c’est qu’elles passent d’une méthode à une autre sans comprendre les racines historiques de ces méthodes et le continuum qu’elles forment : on est passé des « équipes semi-autonomes » expérimentées dans les usines Volvo au lean management inspiré des usines Toyota, puis aux méthodes « agiles » nées dans le monde informatique, comme des girouettes s’essayant à l’air du temps. Un peu de recul historique et théorique leur permettrait de comprendre les liens entre ces courants : les méthodes « agiles » représentent une synthèse de la philosophie d’amélioration continue du modèle japonais et des équipes auto-organisées scandinaves.
Si l’innovation a changé de secteur, ce n’est pas pour rien : l’objet iconique de notre époque n’est plus la voiture individuelle, comme dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais l’informatique. Aujourd’hui, c’est au tour des entreprises « libérées », et on continue de passer d’une mode à l’autre sans comprendre que tous ces courants font partie d’un même mouvement théorique et pratique qui incite les entreprises à sortir définitivement du modèle tayloriste et fordiste, qui n’est plus adapté ni au monde économique « VICA » (« volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté », en mouvement permanent), ni aux attentes au travail (réaliser un travail de qualité dans de bonnes conditions). Ces filiations cachées par les effets de mode donnent du sens aux transformations organisationnelles et managériales des entreprises, ce qui manque aux acteurs internes, ballottés d’une lubie gestionnaire à une autre, sans compréhension des enjeux et du bien-fondé de ces transformations. Un autre travers de ces modes est qu’elles sont souvent imposées hiérarchiquement, sans concertation avec les acteurs internes et leurs besoins réels au travail.
L’ubérisation, résurgence du taylorisme
Allons-nous vers davantage de subsidiarité accordée aux salariés dans le pilotage du travail ? [1] D’un travail prescrit à un travail plus autonome et enrichissant, en particulier dans les emplois industriels ?
S. C. : C’est effectivement ce vers quoi ces nouveaux modes de management et d’organisation nous incitent à aller. De là à dire que ces pratiques (subsidiarité et autonomie) sont en passe de devenir majoritaires, il y a un pas que je ne franchirai pas. Il existe encore de nombreuses entreprises qui fonctionnement sur le mode tayloriste-fordiste et certains phénomènes puissants viennent même exacerber cette modalité de pilotage basée sur le contrôle et la discipline, comme l’ubérisation.
Par ailleurs, pour franchir ce cap, il va être nécessaire de complexifier un peu la vision qu’on a de l’autonomie en entreprise. L’entreprise n’est pas le lieu de la liberté individuelle, sinon on exerce son métier en tant qu’indépendant : c’est le lieu de l’action collective. Si autonomie il y a, elle doit se concevoir collectivement, c’est-à-dire en concertation, au moins avec une équipe et un manager. Mathieu Detchessahar [2] préfère ainsi parler d’« entreprise délibérée » plutôt que d’« entreprise libérée ». Ce changement de cadre est essentiel, car l’autonomie individuelle peut non seulement désorganiser l’activité productive mais également être un facteur d’anxiété pour les personnes qui ne sont pas habituées et n’aspirent pas à prendre des initiatives quotidiennes dans leur travail. En termes de management, il ne s’agit donc pas de passer du micro-management au laisser-faire, où on laisse chacun se débrouiller seul. Il s’agit d’apporter du soutien à chacun, et d’orchestrer l’intelligence collective dans une équipe.
Par objectifs et par soutien
Côté « cols blancs », le télétravail a-t-il porté les pratiques managériales vers davantage d’autonomie ?
S. C. : Si on parle d’autonomie individuelle, le télétravail peut effectivement la favoriser : en étant à distance de son manager et de son équipe, on peut disposer de plus de liberté dans ses méthodes de travail mais aussi dans la gestion de ses horaires. Évidemment, cela suscite la crainte de dérives chez certains managers, ce qui peut enclencher un mouvement inverse à l’autonomie avec une surveillance accrue par les techniques numériques (surveiller les heures de connexion, l’historique de navigation internet, voire les frappes de clavier et les mouvements de souris). S’enclenche alors un jeu malsain : de nouveaux logiciels sont sans cesse créés pour contourner ces pratiques de surveillance, par exemple des logiciels stimulant des signaux de mouvements de souris ou de frappes de clavier. Les salariés qui se savent surveillés ont des réactions contrastées : 51 % vivent mal cette surveillance, qui brise le lien de confiance et ajoute du stress, mais 49 % disent aussi qu’elle leur permet de montrer à leurs managers leur fort engagement et d’objectiver leurs heures supplémentaires, qui sont souvent non rémunérées.
L’un des enjeux ici est de comprendre que le contrôle ne disparaît pas avec la distance, il se déplace : il ne s’exerce normalement plus sur l’activité en train de se faire mais sur les résultats de cette activité. Ce qui nécessite de passer du micro-management au management par objectifs : qu’importe les méthodes et horaires de travail, à partir du moment où les résultats attendus sont atteints. Encore faut-il pour le manager être en mesure de connaître la charge de travail « réelle » et « ressentie » [3] de chacun de ses subordonnés, pour éviter d’accroître la surcharge de travail et la dislocation des temps de vie (où le travail empiète sur la vie privée au point de l’envahir complètement avec la « laisse électronique » [4] des outils numériques). Il ne s’agit donc pas seulement de management par objectifs mais aussi de management de soutien : soutien professionnel (organisation du travail claire, mécanismes de coordination et dispositifs d’entraide) et soutien psycho-sociologique (écoute active, bienveillance, empathie), qui vont permettre d’adapter la charge de travail, les objectifs et les ressources allouées.
Reste la question de cette autonomie collective concertée avec le manager et l’équipe : est-elle possible à distance ? On ne le saura que lorsqu’on arrêtera de calquer les pratiques propres au travail sur site dans le monde virtuel (les réunions en visio ou le présentéisme numérique en sont quelques exemples).
Tous les salariés aspirent-ils à voir leur emploi gagner en « sens », s’il est aussi plus lourd en responsabilités ?
S. C. : Il faut déjà se mettre d’accord sur ce qu’on entend par un emploi « qui a du sens ». Thomas Coutrot et de Coralie Perez[5] ont dégagé trois composantes du sens du travail : « l’utilité sociale (“Mon travail est-il utile aux autres ?”) ; la cohérence éthique (“Mon travail me permet-il de respecter mes valeurs personnelles et professionnelles ?”) et la capacité de développement (“Mon travail me permet-il de développer mes facultés, ma sensibilité, mon intelligence, mon expérience”) ». Quand on parle de quête de sens, on a tendance à se focaliser sur l’utilité et les retombées sociales, en mettant d’ailleurs l’accent sur l’environnemental plus que sur le social. Mais les autres composantes du « sens » montrent l’importance de l’organisation et des conditions du travail.
Vu sous cet angle, la responsabilité des salariés doit aller au-delà de l’autonomie individuelle : s’il s’agit de se débrouiller seul pour atteindre des objectifs définis par des chiffres financiers, ça ne risque pas de faire sens pour grand-monde. S’il s’agit de prendre des responsabilités en étant soutenu par un manager et une équipe, pour accomplir des missions utiles aux autres et à son développement personnel, sans pour autant détruite la planète et le tissu social, il y a plus de chance de trouver du sens au travail.
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a publié l’année dernière avec l’Assurance maladie une étude prospective sur les enjeux de sécurité au travail à l’horizon 2040, à laquelle vous avez contribué ; quelles grandes tendances se dessinent et que doivent anticiper prioritairement les entreprises ? [5]
S. C. : Pour résumer ce rapport touffu, je mettrai en avant trois enjeux : flexibilisation de la main-d’œuvre, numérique, RSE.
Précarisation sanitaire
La flexibilisation de la main-d’œuvre (sous-traitance, intérim, contrats courts, auto-entreprise) risque de s’intensifier face aux fluctuations rapides de la demande et des évolutions conjoncturelles. Cette tendance pourrait conduire au développement d’entreprises unipersonnelles où chaque travailleur devient une unité économique à laquelle peuvent être confiées des tâches plus ou moins complexes pour des durées plus ou moins longues. Dans un contexte où les travailleurs changent tout le temps, travaillent à distance, développent une multi-activité, connaissent une carrière fractionnée ou relèvent de statuts différents, une culture de la prévention des risques en matière de santé est difficile. Cette fragmentation du travail en de multiples entités risque d’affaiblir les collectifs, de compliquer le suivi par les acteurs de la prévention et de diluer les responsabilités en matière de santé et sécurité au travail.
La numérisation contre la diversité
Le recours accru aux technologies numériques, lui aussi tendanciel, nourrit le développement d’un management algorithmique qui pourrait renforcer l’encadrement prescriptif et le contrôle des travailleurs, tout en se substituant à l’encadrement intermédiaire. Cette tendance risque de renforcer l’écart entre le travail prescrit et le travail réel, et pose des questions éthiques (accès aux données, respect de la vie privée). Cette numérisation accélérée affecte aussi le développement des compétences. Avec l’automatisation et l’intelligence artificielle, les tâches répétitives ou exigeantes, autant sur le plan physique qu’intellectuel, sont transférées aux machines. En contrepartie, les travailleurs doivent développer de nouvelles aptitudes : capacité d’adaptation, d’apprentissage, flexibilité et polyvalence, alignement avec la mission d’entreprise et son mode de management. Dans ce contexte, les compétences « métiers » (qui intègrent les savoir-faire de prudence) risquent d’être dévalorisées au profit de notions plus subjectives (« soft skills », savoir-être) qui pourraient accroître les exigences émotionnelles au travail, notamment le surengagement. La recherche de profils disposant d’un même système de valeurs et de comportements socio-culturels communs pourrait aussi accentuer l’homogénéisation des milieux de travail et conduire à la discrimination de travailleurs ne disposant pas des mêmes codes sociaux malgré un bon niveau de compétences.
Déréalisation par la notation
Les nouvelles préoccupations des entreprises (RSE, sociétés à mission) et les nouveaux modes d’organisation (lieux et horaires de travail flexibles), guidés par de bonnes intentions, peuvent susciter de nouveaux risques : l’accent mis sur l’environnement, l’inclusivité, le « care » peut conduire à porter une moindre attention aux conditions de travail, avec des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs. Ces effets peuvent devenir difficiles à mesurer, en raison des systèmes d’évaluation propres aux nouvelles modalités de pilotage : évaluations quantitatives centrées sur le résultat, fondées sur la collecte de données à distance, notation par les clients, usagers, collègues, au détriment d’une approche plus qualitative et compréhensive. 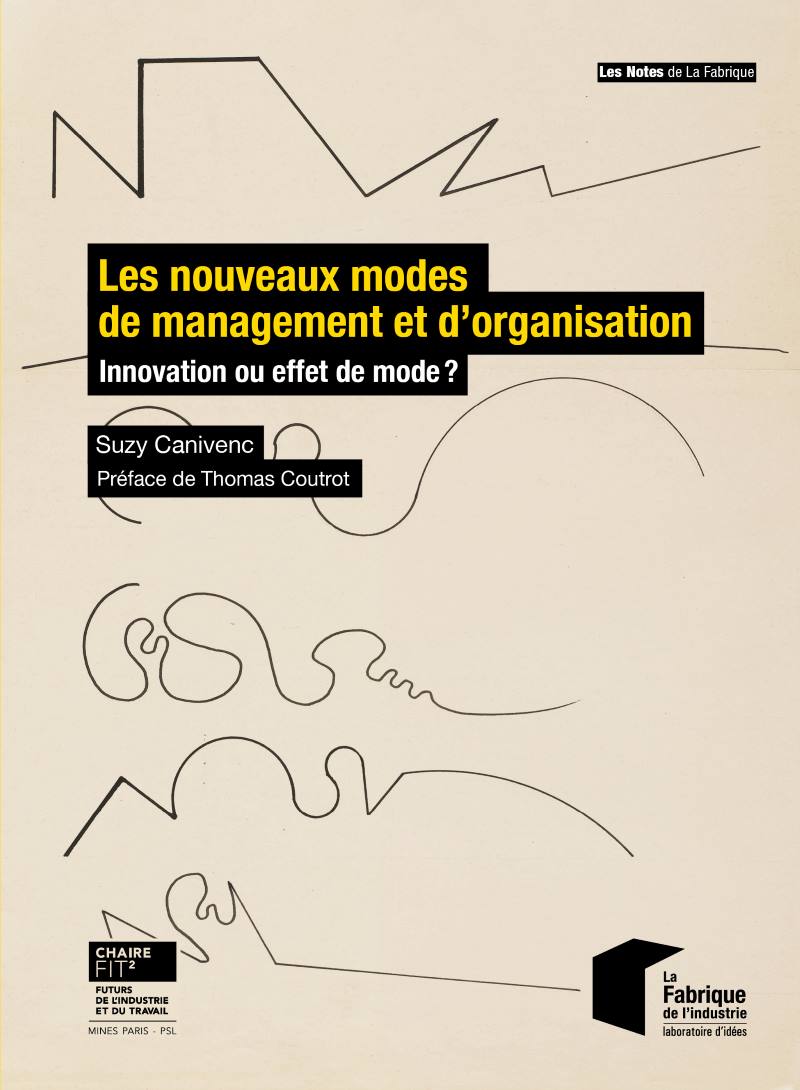 Ce type de notation nous éloigne toujours davantage du travail réel et vécu par les personnes. Par ailleurs, les organisations pourraient avoir de plus en plus de difficultés à aligner leurs pratiques sur leur discours, alimentant les dissonances cognitives porteuses de risques psycho-sociaux.
Ce type de notation nous éloigne toujours davantage du travail réel et vécu par les personnes. Par ailleurs, les organisations pourraient avoir de plus en plus de difficultés à aligner leurs pratiques sur leur discours, alimentant les dissonances cognitives porteuses de risques psycho-sociaux.
Les salariés qui s’investissent activement dans les « nouveaux mode de management et d’organisation » sont-ils davantage confrontés à des risques psychosociaux (stress, surcharge cognitive…) ?
S. C. : Les « NMMO » peuvent en effet accentuer les risques psycho-sociaux, notamment du fait de cet amalgame entre autonomie en entreprise et autonomie individuelle qui dérive vers le « débrouille-toi tout seul ». Si cette injonction peut être vécue comme un vecteur d’émancipation pour certains, d’autres la vivent comme un facteur d’anxiété et de tension. Si dans la même équipe vous avez ces deux profils, cela peut aussi nuire au climat social en exacerbant les incompréhensions mutuelles. Il y a donc des risques psycho-sociaux au niveau individuel et collectif.
Le premier point de vigilance est d’écouter avec sincérité les réticences qui s’expriment, car elles sont précieuses pour comprendre les défaillances des pratiques que l’on met en place dans une logique d’amélioration continue (en actant qu’on n’atteint pas la perfection du premier coup, nécessaire posture d’humilité dans la conduite des transformations organisationnelles). Il faut bien être conscient que toute transformation organisationnelle est abrasive : elle bouscule les identités professionnelles mais aussi les relations interpersonnelles. Être à l’écoute de ces secousses nécessite des méthodes de conduite du changement participatives, où les acteurs peuvent avoir prise sur la mise en œuvre de la transformation, ce qui permet de développer un modèle organisationnel réellement adapté aux besoins opérationnels de l’activité et aux aspirations individuelles, toujours différents d’une entreprise à l’autre. Écoute sincère, humilité, prudence et patience sont indispensables pour éviter d’exacerber les risques psycho-sociaux mais aussi les dysfonctionnements. Sinon on perd sur tous les tableaux, qualité de vie au travail comme productivité.
Les métiers agricoles parmi les plus exposés
Vous avez engagé une réflexion sur les conséquences du dérèglement climatique pour les conditions et l’organisation du travail [6]. Quelles conséquences en termes d’attractivité des emplois ?
S. C. : L’enjeu concerne avant tout les conditions de travail et les conséquences sanitaires, qui ont évidemment un effet sur l’attractivité de certains métiers. L’élévation des températures va accentuer la pénibilité des métiers physiques s’exerçant en extérieur (BTP, agriculture…), le risque de coup de chaleur létal mais également les effets indirects comme une baisse de vigilance qui peut accroître le nombre d’accidents du travail déjà élevés dans ces métiers. Les fortes chaleurs peuvent aussi dégrader les métiers de bureau avec une baisse de performances cognitives. Le dérèglement climatique ne se limite pas à l’élévation des températures, comme en témoigne la multiplication des événements extrêmes (tempêtes, pluies diluviennes, crues) qui accroît encore les risques pour les métiers d’extérieur. Les plus touchés seront les personnels de secours et de nettoyage, qui vont être de plus en plus sollicités, au risque du burn-out. Il est donc important d’adapter l’organisation et les conditions de travail à ces effets déjà visibles et qui vont s’aggraver : aménager les horaires, repenser l’aménagement des bâtiments et des lieux de travail, faire évoluer les équipements de protection individuelle, etc.
Engagement réciproque
Qu’attend-on prioritairement et que va-t-on attendre de plus en plus d’un bon management : efficacité, rationalité, créativité… ?
S. C. : Le management a pour rôle d’optimiser l’action collective en amenant chacun à son plus haut potentiel : un moyen d’atteindre l’efficacité et la créativité, dans un monde où l’innovation est reine et oblige toutes les entreprises à s’adapter en permanence. La méthode pour le faire est bouleversée : il ne s’agit plus de pousser les individus à atteindre leur productivité maximale, mais de les accompagner dans leur montée en compétence. Le manager n’est plus là pour mettre un coup de pied aux fesses, mais pour prendre ses « collaborateurs » par la main. Il est intéressant de revenir à l’origine du mot « management » qui viendrait du latin manus agere, « conduire avec la main ». « Manager » c’est donc aussi « ménager », prendre soin [7] . C’est d’autant plus vrai dans une économie où la première force productive n’est plus physique mais cognitive ; ce qui s’obtient difficilement par la contrainte. Cette évolution substitue au traditionnel lien de subordination (inscrit dans le Code du travail) un rapport de réciprocité : les salariés sont prêts à s’engager pour des entreprises qui s’engagent pour eux, au-delà du seul contrat de travail et de la paie.
Les « NMMO » se heurtent-elles à des résistances ?
S. C. : Toute transformation est anxiogène pour celui qui la vit, parce qu’elle oblige à abandonner ses routines, qui apportent sécurité et efficacité, pour inventer et s’adapter à des pratiques inconnues. On comprend souvent ce qu’on va perdre, on ne perçoit pas toujours les gains potentiels. C’est une réaction normale, logique et rationnelle. Par ailleurs, les salariés témoignent souvent d’incertitudes quant à leurs capacités à endosser les rôles qui leur sont demandés dans le cadre des NMMO : les managers doivent se départir de certaines prérogatives, que les salariés doivent désormais assumer. Les uns doivent passer de chefs à facilitateurs, les autres d’exécutants à décideurs du quotidien. Ce qui n’est pas du tout « naturel » dans les entreprises contemporaines.
Cette résistance évolue : elle était le propre des opérationnels, elle concerne aujourd’hui tout autant la ligne managériale, dont le rôle est bouleversé mais pas toujours très clair. Mais si elle se généralise, elle est de moins en moins exprimée collectivement et a donc moins de poids. L’individualisation des revendications conduit à ce qu’elles soient moins écoutées et prises en compte. Une situation qui mène souvent les réticents au mutisme, voire au départ volontaire. Il est nécessaire d’aller au-delà des stéréotypes sur le « résistance au changement » qui confortent une certaine « paresse managériale » [8].

